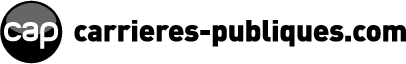Administrateur, rédacteur, animateur, ingénieur, agent de maitrise…voici quelques-uns des concours de la fonction publique territoriale qui se dérouleront en 2025. Quels sont les sujets d’épreuve de note de synthèse, de rapport qui pourraient tomber ? Voici 6 thèmes « pronostic », pour vous aider dans vos révisions et réussir vos concours.
1. Gestion de l'eau et durabilité : Un thème envisageable en 2025
La question de l’eau touche le quotidien des habitants, leur santé, leur sécurité et leur lieu de vie. Cette ressource essentielle n’a pourtant rien d’infini ni d’immuable. Un foyer français consomme en moyenne 147 litres d’eau potable chaque jour (Source : environnement.gouv.fr). Son accès peut sembler une évidence… pourtant celle-ci se raréfie.
La ressource disponible sur le territoire a baissé de 14 % en 20 ans sous l’effet de la pression humaine et du changement climatique. Seules 45 % des masses d’eau sont en bon état écologique d’après le dernier état des lieux partagé en 2019. Faute d’une qualité suffisante, plus d’une centaine de points de captage d’eau ferment chaque année.
Les collectivités doivent faire face à des difficultés grandissantes, une gestion de l’eau accentuée par le changement climatique et au « mur d’investissement ». Aussi, elles doivent réfléchir à des approches durables garantissant un approvisionnement en eau fiable et sûr.
Sans devenir un expert, il s’agit de vous habituer à lire des articles sur le thème, d’acquérir du vocabulaire, de la technicité (exemple : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPI), pour comprendre les enjeux et le déploiement lié. Notamment, il sera important que vous sachiez que parler de la gestion de l’eau, c’est aborder le « petit cycle » (alimentation en eau potable, traitement des eaux usées) et le « grand cycle » (désimperméabilisation, gestion des eaux pluviales, GEMAPI). Si le « ?grand cycle? » reste dans le giron des mairies, les compétences relatives à l’eau potable et à l’assainissement seront transférées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’ici au 1er janvier 2026.
Une mutualisation administrative des compétences, connaissances et moyens qui, adossée plus largement à l’échelle du bassin, devrait favoriser l’action (source : Banque des territoires). Une des questions du jury pourrait être : « Pénurie d’eau, mise en œuvre de la GEMAPI et prévention des risques et pollution : comment agir collectivement pour répondre à l’urgence d’agir ? »
Un des sujets possibles pourrait être « la crise de l’eau en outre-mer », où la question est encore plus sensible : pénurie grandissante obligeant à des tours d’eau, risque inondation croissant avec l’augmentation des tempêtes cycloniques, fragilité de la ressource face aux pollutions, infrastructures à rénover,… les problématiques sont nombreuses, complexes et nécessitent une action urgente sur tous les fronts de l’amont à l’aval. Les autorités de l’État ont lancé, à partir de 2016, un plan « eau Dom » (Pedom), destiné à soutenir particulièrement les cinq régions et départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), ainsi que la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Pour aller plus loin sur ce dossier et vous aidez à réviser, vous pouvez lire un rapport très intéressant de la Cour des comptes intitulé « La gestion de l’eau potable et de l’assainissement en outre-mer », publié au mois de mars 2025.
Le jury pourrait par exemple vous demander : « Face à la « crise de l’eau », quels partenariats se mettent en place pour répondre à chaque territoire en fonction des enjeux et des modes de gouvernance (agences de l'eau, établissements publics territoriaux de bassin, …) ? »
2. L’évolution des services publics : La médiation territoriale
Enfin reconnue par la loi « Engagement et proximité » promulguée le 27 décembre 2019, la médiation territoriale dont le cadre juridique est défini à l’article L. 112-24 au code général des collectivités territoriales, participe à l'apaisement des relations avec les usagers des services publics. Ce sujet pourrait être posé aux concours en 2025.
Dans une société de plus en plus agitée par les conflits entre habitants et institutions publiques, marquée à la fois par une inflation normative pas toujours évidente à suivre et l’engorgement des tribunaux, la médiation a tout pour plaire, et en particulier dans les collectivités territoriales.
Les communes et communautés de communes ont par nature plus de proximité avec leurs habitants, et ont intérêt à entretenir avec eux un climat de confiance apaisé. Les départements ne sont pas en reste, puisqu’ils sont en charge, notamment, des politiques sociales et de solidarité, et s’adressent à des publics plus démunis et pour lesquels le juge est moins accessible. Enfin, les compétences des régions concernent aussi les particuliers et les entreprises (transports, lycées, etc.) (source : gazette des communes).
Reste que ce métier n’est pas facile, dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, le médiateur est chargé souvent après audit du fonctionnement des services, d’organiser et de mettre en œuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différend, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une situation de droit, en faisant des propositions d’amélioration des process de travail.
Le jury pourra donc vous poser les questions suivantes : « Comment la médiation territoriale peut contribuer à l’amélioration du service rendu aux habitants ? ; « La médiation est-elle une alternative au contentieux ? » ; « Conflits internes entre agents, litiges liés aux marchés publics, litiges entre élus, les médiateurs interviennent dans une multitude de domaines, mais avec quels outils ? »…
3. Complémentaire santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale
Les questions liées aux Ressources Humaines et à la gestion de celles-ci sont récurrentes dans les concours territoriaux : après la mise en place des 1607 heures, le télétravail, les conditions de rémunération des agents et leur bien-être peuvent être des sujets parfaits en 2025.
Aujourd'hui, certains fonctionnaires, notamment ceux aux revenus modestes, sont exposés à des frais de santé importants, faute de mutuelle adaptée.
Ces dernières années, la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux connaît de profonds changements. La participation de l’employeur public à la complémentaire santé-prévoyance des agents existe dans les autres fonctions publiques depuis 2007. Mais il a fallu attendre le 10 novembre 2011 pour que les fonctionnaires territoriaux puissent en bénéficier.
Depuis l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les employeurs publics sont obligés à participer au financement d’une partie de la complémentaire « santé » et « prévoyance » souscrite par leurs agents. Avec cette réforme, l'État s'engage à couvrir 50 % des cotisations des agents.
Depuis le 1er janvier 2025, collectivités et établissements publics territoriaux ont désormais l’obligation de participer au financement du risque « Prévoyance » (risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou au décès) de leurs agents. Il était temps diront certains : si plus de 90 % des territoriaux bénéficient d’une complémentaire « santé », seuls 40 % souscrivent à une garantie de maintien de salaire.
L'obligation pour les employeurs publics de contribuer au risque Santé, également appelé « Mutuelle » (coût de la complémentaire santé) de leurs agents entrera en vigueur quant à elle en 2026. Une situation qui conduit nécessairement les employeurs territoriaux, les directions des ressources humaines (RH) et les organisations syndicales à entamer des négociations et à trouver un accord pour sa mise en œuvre à l'échelle locale.
L'instauration d'une mutuelle obligatoire dans la fonction publique répond à deux objectifs principaux : garantir l'égalité entre le public et le privé, améliorer la couverture santé des fonctionnaires et les conditions de rémunération des agents en cas d'incapacité à travailler, tout en renforçant la solidarité entre tous les agents publics.
« Quel est le rôle du dialogue social (Comité social technique) dans la mise en œuvre de la réforme PSC ? » ; « Quelles actions de sensibilisation à l’attention des personnels peuvent être mises en place ? » ; « Quelles sont les mesures visant à limiter les inégalités face aux dépenses de santé et favoriser le bien-être des agents dans leurs missions quotidiennes ? »...sont quelques-uns des sujets possibles en 2025 en lien avec cette thématique.
4. Jeunesse, Éducation et Sport : Après les jeux, accueillir l'afflux de nouveaux sportifs
Quelques mois après la fin des jeux olympiques et paralympiques (JOP), un des sujets de note de synthèse ou de rapport pourrait être : « Dans les territoires, quelles seront les perspectives du sport français pour les prochaines années ? »
Les Jeux auront été un puissant catalyseur pour la politique sportive des français avec des investissements importants dans les équipements sportifs et de fortes ambitions dans le développement des activités physiques et sportives.
Alors que le sport est confronté à de nouveaux enjeux, voici un exemple de sujet qui pourrait être proposé aux concours territoriaux en 2025 : « Comment articuler les injonctions contradictoires entre la nécessité du développement des équipements sportifs et les impératifs de sobriété énergétique ou foncière dans un contexte financier contraint ? ». Sur ce dernier point, si les moyens financiers de l'Agence nationale du sport (ANS) sont globalement maintenus pour 2025 (cf. « plan 5.000 équipements » de l’ANS), les communes doivent faire preuve d'inventivité pour financer et rénover leurs équipements sportifs. Elles sont de plus en plus nombreuses à penser à la mutualisation, notamment avec les équipements scolaires.
Les sportifs changent également. La course et la marche ainsi que les activités de la forme et de la gymnastique sont les univers d’activités sportives qui ont enregistré la plus forte arrivée de pratiquants réguliers entre 2018 et 2022. Dans le même temps, trois français sur dix n’ont pas obtenu l’inscription demandée en club ou en association, pour eux ou un proche, au cours des cinq dernières années.
Dans ce cadre, il est demandé aux préfets, en lien avec les collectivités locales, le mouvement sportif et les acteurs économiques d'informer le grand public de l'offre disponible sur le territoire et de favoriser son orientation vers les clubs ou les offres qui ne sont pas saturés afin de leur permettre d'accéder à une pratique sportive. Et, de manière plus durable, de faciliter les expérimentations en lien avec les acteurs des territoires afin de permettre l'émergence de nouvelles formes de pratiques susceptibles d'accueillir un nombre croissant de pratiquants.
Le jury pourrait donc vous questionner ainsi : « Comment intégrer les nouvelles formes de pratiques dans les politiques sportives locales ? » ; « Comment faire face à la baisse de l’engagement associatif, au cœur du modèle sportif français ? ».
Au chapitre de l’actualité du sport, savoir ce qu’est le dispositif Pass’sport même si son taux de recours est encore faible (source : Localtis), que des campagnes en faveur de l'encadrement des pratiquants, qu'il s'agisse de la promotion du métier d'éducateur sportif, du service civique dans les clubs ou du bénévolat sont en cours de déploiement pourra être un plus dans vos réponses.
5. Finances publiques : Capacité d'action des collectivités et mesures financières imposées
Si la tension dans les relations financières entre l’État et les collectivités locales n’est pas nouvelle, puisque la crise financière de 2008 avait déjà donné lieu à une réduction brutale des dotations versées aux collectivités, elle semble aujourd’hui avoir atteint son paroxysme.
L’État considère que les collectivités sont pour partie responsables de la « dérive actuelle des comptes publics » et souhaite limiter la dépense locale au nom du redressement des comptes publics (avec un objectif de déficit public à 5,4% du PIB en fin d’année 2025), tandis que les collectivités mettent en avant le décalage croissant entre les responsabilités qui leurs sont confiées dans la mise en œuvre des services publics et le manque de moyens financiers (notamment du fait des transferts de compétences sous-financés accroissant ainsi la dépendance des collectivités vis-à-vis de l’État), pour y parvenir.
Dans ce cadre, depuis 2010, quelque 70 décisions (suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), réduction des impôts des locaux industriels…) ont été prises concernant directement la fiscalité locale.
Qu'elles soient de nature budgétaire ou réglementaire, ces multiples décisions de l'État pèsent lourd sur les finances des collectivités locales et participent au « découragement » que ressentent nombre d'élus locaux pour répondre aux défis auxquels les politiques publiques sont confrontées : vieillissement de la population, atténuation de la fracture sociale, transitions écologiques,…
D'une complexité croissante, ces normes mettent les élus « face à des injonctions contradictoires » et ne sont pas toujours appliquées de la même manière par l'administration de l'État. Non seulement elles induisent des coûts pour les finances locales, mais elles « entravent » l'action des élus locaux (Source : Sénat, juin 2023).
Un des sujets aux concours en 2025 pourrait être notamment dans les spécialités de finances publiques, de répondre à la question : « Dans un contexte de contrainte financière, comment arriver à une efficacité accrue de la dépense publique locale ? » ; ou encore, parce que parfois c'est l'empilement de couches, de contrôles, ou d'administrations qui empêche l'efficacité de l'action publique, « Quel doit être le rôle du préfet auprès des élus locaux en 2025 ? ». Une des pistes évoquée par les sénateurs en 2023, serait qu’il devienne un « interlocuteur privilégié » des collectivités territoriales, par la mise en place, dans certains départements, des conférences de dialogue, ou encore, par le renforcement de son rôle et celui du sous-préfet en matière de conseil et d’ingénierie ou bien, la simplification de la procédure relative au « droit de dérogation du préfet ». Autant de notions qu’il vous faudra maitriser pour gagner des points le jour des épreuves.
Dans ce cadre, vous pourrez notamment, souligner que les acteurs des services publics considèrent, outre l’inflation législative, que les normes sont devenues plus complexes ces trois dernières années, entraînant des conséquences négatives sur certains de leurs projets notamment en matière d'urbanisme. Une situation qui conduit certains députés à proposer des mesures de simplification en matière d’urbanisme pour permettre aux projets de sortir plus vite de terre (ex. généralisation du permis d’aménager « multisites », délais de recours raccourcis, renforcement des outils d’ingénierie, dérogations au PLU pour l’ensemble des communes tendues...).
6. Autre thème possible en 2025 : Les maires face au narcotrafic
Enfin, le trafic de stupéfiants connait l’accélération de développements liés à :
- l’approvisionnement : transport international et national, production locale, …,
- la distribution : « uberisation du shit », multiplication des points de deal, violences sur ces points et près de services publics (ex. « jambisation »), rajeunissement des trafiquants, …,
- la consommation : augmentation du nombre de consommateurs, nouveaux produits, banalisation des produits les plus nocifs, …,
impliquant des conséquences directes pour les maires : sécurité publique, politique de la jeunesse, logement, corruption d’acteurs locaux, apparition de drogues de synthèse qui altèrent santé mentale et comportement,... (source : WEKA)
Ce tableau désormais touche également les petites villes, les villages et les secteurs ruraux. Cela étant, cette situation, qui crée chez les élus un « sentiment d’impuissance », ne doit pas conduire à la résignation à voir des parties des territoires français se transformer en « zones de non-droit ».
Voici donc un thème d’actualité qui pourrait être posé aux concours territoriaux en 2025. Si le sujet est avant tout de la responsabilité de l’État, celui-ci ne peut pas tout faire, et il faut une coordination locale/nationale. Lutter contre le trafic de drogue nécessite une réponse partenariale réunissant les maires, les forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie) et la justice (cf. stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), ….). Par ailleurs, des solutions sont à développer et à expérimenter pour nourrir la qualité du dialogue et des partenariats (Éducation nationale, bailleurs, transporteurs…) avec les forces de sécurité.
Pour vous étoffer vos connaissances sur ce thème, le rapport sénatorial « Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic » publié au mois de mai 2024 et sa synthèse offrent un bon support.
En conclusion, ces 6 thèmes sont à la mode, toutefois, cela ne veut pas dire, qu’ils sont les seuls.
Prenez bien soin de relire les articles sur les thèmes pouvant « tomber » en 2024 (développement économique des territoires et aménagement foncier ; label et qualité du service rendu ; égalité salariale entre femmes et hommes ; le service public de la petite enfance ; les impacts de la guerre en Ukraine sur les collectivités territoriales ; finances publiques et crise énergétique), et surtout, de suivre l’actualité.
Pour mieux retenir vos lectures, faites-vous des fiches thématiques et bien sûr, lisez régulièrement la presse spécialisée et nationale.
Pourquoi compléter vos révisions par des travaux corrigés ?... Pour renforcer vos connaissances
Dernier conseil : gardez à l’esprit que les épreuves sont là pour vous mettre en situation professionnelle ; le traitement des sujets requérant fréquemment, des propositions sur la manière de conduire un projet, pensez à réviser la méthode.
Une préparation, des travaux dirigés ou encore une formation intensive, par exemple, sera pour vous le meilleur moyen d’acquérir non seulement une méthode de rédaction efficace mais également des supports de connaissances à jour. Sous forme d’entraînements, de mises en situation professionnelle, de quizz, de fiches thématiques, notamment, ces préparations spécifiques proposent un suivi rapproché. En bonus, des conseils en direct vous seront prodigués par les intervenants (ex. « A quoi doit servir le brouillon ? Comment rédiger une bonne introduction ?... »).
Bonnes révisions avec Carrières Publiques !