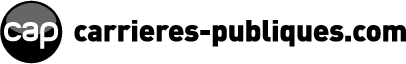Dans le cadre de leurs fonctions, tous les agents publics qu’ils soient fonctionnaires d'État, territoriaux ou hospitaliers, stagiaires ou contractuels sont tenus de s’astreindre au respect d’un ensemble de règles et de principes qui les distinguent des salariés du secteur privé. En contrepartie, ils bénéficient de certains droits fondamentaux. Explications … en 5 points, pour être incollable le jour des épreuves de votre concours.
1. Le code général de la fonction publique définit les garanties et obligations des fonctionnaires
Travailler au service de l’intérêt général réclame de l’exemplarité. C’est pourquoi un fonctionnaire a des devoirs liés à son statut. Des obligations professionnelles et morales (déontologiques) plus nombreuses dans le public que dans le privé, et des droits en contrepartie qui sont précisés par le code général de la fonction publique (CGFP - paru en 2022). Ce dispositif législatif et réglementaire (décrets d’application), issu du Statut général de la fonction publique, a vocation à définir un socle de règles communes à l'ensemble des fonctionnaires.
Parmi ces dispositions législatives statutaires, on peut citer :
- La loi 83-634 du 13 juillet 1983,
- La loi 84-16 du 11 janvier 1984,
- La loi 84-53 du 26 janvier 1984,
- La loi 86-33 du 9 janvier 1986.
Ce corpus de règles est complété par le juge administratif ; certains droits et obligations n’ayant qu’un fondement jurisprudentiel.
2. Les 9 droits des fonctionnaires
Ils sont au nombre de neuf :
1. droit à la protection contre la discrimination, le sexisme et le harcèlement, la liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse
2. droit à la rémunération après service fait
3. droit syndical
4. droit de grève
5. droits sociaux de participation
6. droit à la protection juridique par l’employeur
7. droit à la formation permanente
8. droit de saisir un référent déontologue et un référent laïcité
9. droit à la protection des lanceurs d’alerte
1 - Droit à la protection contre la discrimination
(articles L 131-1 à L 131-13 du Code général de la fonction publique)
Lorsqu’un employeur public recrute un agent, il doit respecter un des droits essentiels des agents publics, celui de la liberté d'opinion qui implique qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Cette liberté doit être garantie par la suite, au cours des missions des fonctionnaires. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles (ex. pour intégrer des fonctions militaires au sein de l’armée), justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.
2 - Droit à la rémunération après service fait
(article L 115-1 du Code général de la fonction publique)
Les fonctionnaires ont droit, « après service fait », à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que diverses primes et indemnités. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.
Toute période non travaillée entraîne en conséquence une réduction de la rémunération dans les conditions prévues par la réglementation sur la comptabilité publique. Ainsi, une retenue égale à 1/30e du traitement mensuel doit être appliquée à l’ensemble de la rémunération par jour de service non fait. Trois grandes catégories de situations peuvent engendrer une réduction de la rémunération pour absence de service fait : le cas général qui recouvre les congés non rémunérés et les absences non justifiées, les absences pour motif de grève et celles motivées par un motif disciplinaire ou de suspension.
3 - Droit syndical
(articles L 113-1 et L 113-2 du Code général de la fonction publique)
Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service, selon les « nécessités de service ».
Bien qu’elle ne soit pas définie précisément dans les textes réglementaires, la nécessité de service ou « intérêt du service » est guidée par le principe de continuité du service public.
4 - Droit de grève
(articles L 114-1 et L 114-7 à L 114-10 du Code général de la fonction publique)
La jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales.
L’exercice de ce droit connaît par ailleurs, des restrictions. En effet, l’autorité administrative peut « prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité » (arrêt « Jamart », 1936). Dans cet esprit, les règles statutaires (lois et règlements) peuvent être modifiées par le chef de service « dans l’intérêt du service ». L’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation.
D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats judiciaire, CRS.
5 - Droits sociaux de participation
(article L 112-1 du Code général de la fonction publique)
Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières.
Les agents participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
6 - Droit à la protection juridique par l’employeur
(articles L 134-1 à L 134-12 du Code général de la fonction publique)
L’employeur public a l’obligation légale de protéger son agent contre les atteintes et attaques volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte.
Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour une faute de service, l’employeur doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
7 - Droit à la formation
(articles L 115-4 et L 115-5 du Code général de la fonction publique)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
8 - Droit de saisir un référent déontologue et un référent laïcité
(articles L 124-2 et L 124-3 du Code général de la fonction publique)
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques auxquels il est soumis.
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a donné un nouvel élan à la laïcité en instaurant l’obligation de former tous les agents des trois versants de la fonction publique au principe de laïcité et en créant des référents laïcité dans les administrations. Tout agent public peut consulter le référent laïcité pour toute interrogation liée à l'application du principe de laïcité dans l'exercice de ses fonctions.
9 - Droit à la protection des lanceurs d’alerte
(articles L135-1 à L136-6 du Code de la fonction publique)
Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d'un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de « lanceur d’alerte ». Il ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire pénalisant sa carrière ou sa rémunération, en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence assure une protection accrue des lanceurs d’alerte. La protection des lanceurs d’alertes ne concerne plus seulement la dénonciation des crimes et délits, mais aussi la dénonciation des « conflits d’intérêts » (cf. ci-dessous).
3. Les obligations professionnelles des fonctionnaires
L’obligation de service et le cumul d'activités
(articles L 121-3 et L 123-1 du Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées.
Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité (lucrative ou non), auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. C'est ce que l'on appelle le « cumul d'activités ».
L’obligation d’obéissance hiérarchique
(article L 121-10 du Code général de la fonction publique)
Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions écrites et orales de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la bonne exécution et la continuité du service public. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Ce principe concerne aussi bien les prescriptions générales que les ordres individuels et verbaux.
En revanche, l'agent a également le devoir de désobéir lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. L’ordre doit être « manifestement illégal » et « de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
L'obligation d'information du public
(article L 121-8 du Code général de la fonction publique)
Les fonctionnaires ont le devoir de répondre aux demandes d'information du public, sauf si cela va à l'encontre du secret ou de la discrétion professionnels (cf. Code des relations entre le public et l’administration).
Par ailleurs, « le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ». Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
4. Les obligations morales des fonctionnaires (déontologie)
Au nom de l'administration qu'ils servent, les fonctionnaires sont également soumis aux obligations de dignité, d'impartialité, de probité, de neutralité, de respect du principe de laïcité et d’égalité de traitement.
L'obligation de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité
(article L 121-1 du Code général de la fonction publique)
L’obligation de dignité s’impose à l’agent à raison de sa qualité d’agent public et vise à s'assurer que son comportement (propos, agissements, tenue dans l’exécution des missions du service) ne porte pas atteinte à la réputation de son administration.
L’obligation d’impartialité qui se rattache à d’autres principes tels que l’égalité, la neutralité ou l’indépendance, est inhérente aux missions d’intérêt général. Ainsi, un agent public ne doit pas se laisser influencer ou paraître se laisser influencer par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ses intérêts personnels et familiaux à l’égard des autres agents publics et des usagers.
L’obligation d’intégrité impose que l’agent exerce ses fonctions de manière désintéressée.
L’obligation de probité correspond à l’honnêteté, au respect des biens et de la propriété d’autrui. Elle a ainsi pour objet d’éviter que l’agent public ne se trouve dans une situation dans laquelle son intérêt personnel pourrait être en contradiction avec celui de la collectivité qu’il sert. Il ne peut pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel.
L'obligation de neutralité, de respect du principe de laïcité et d’égalité de traitement
(article L 121-2 du Code général de la fonction publique)
Tout fonctionnaire jouit de la liberté d’opinion, aussi bien politique, syndicale que religieuse. Mais le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction, un instrument de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses.
De fait, il est soumis au principe de laïcité. Ces deux principes font obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public et quelle que soit la nature de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances et leur appartenance religieuses. En portant des signes religieux distinctifs et de manière ostentatoire dans l'exercice de son service, il porterait atteinte à la neutralité de l'administration qui l'emploie. Ces principes sont rappelés dans la Charte de la laïcité dans les services publics rédigée en 2007. Ils sont réaffirmés par la circulaire du premier ministre datée du 15 mars 2017.
Par ailleurs, les agents publics sont tenus de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité (principe d’égalité de traitement). Ils ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un tel comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses.
5. Le contrôle déontologique et la prévention des conflits d’intérêts
Le contrôle déontologique des fonctionnaires est confié à la Haute Autorité de transparence de la vie publique, chargée d'enquêter sur la mobilité des fonctionnaires, le pantouflage ou encore les déclarations d'intérêts.
La prévention des conflits d'intérêts
(articles L 121-4 et L 121-5 du Code général de la fonction publique)
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ? Le conflit d’intérêt correspond à « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Tous les agents se voient imposer la double obligation de faire cesser immédiatement et/ou de prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver (loi déontologie du 20 avril 2016).
En cas de situation de conflit d’intérêts, l’agent doit saisir son supérieur hiérarchique, qui prendra la mesure qui s’impose. Par exemple, il confiera le traitement du dossier à une autre personne. S’il a reçu une délégation de signature, il doit s’abstenir d’en user. Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, il doit s’abstenir d’y siéger ou de délibérer…
L’obligation de secret professionnel
(article L 121-6 du Code général de la fonction publique)
Dans l'exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires : la défense ; les informations financières ; le domaine médical.
L'obligation de secret professionnel vise également à protéger les particuliers. Le fonctionnaire n'a pas le droit de révéler des renseignements à caractère secret recueillis sur des personnes ou concernant des intérêts privés, dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.
Exceptions : le fonctionnaire peut être autorisé à dévoiler des renseignements confidentiels si la personne intéressée a donné son accord ou si cela est nécessaire pour prouver son innocence. Par ailleurs, il peut être tenu de révéler des renseignements confidentiels, dans certains cas, pour aider la justice.
L'obligation de discrétion professionnelle
(article L 121-7 du Code général de la fonction publique)
Il est interdit à tout agent de révéler tout fait, information, document dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à protéger les intérêts du service. Elle s’applique vers l'extérieur, comme au sein de l'administration, c'est-à-dire entre les services.
Limites à l'obligation de discrétion : celles prévues notamment, en matière de liberté d'accès aux documents administratifs et celles sur l'informatique et les libertés ou encore, par décision expresse de l'autorité dont l’agent dépend.
Contrairement à l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions disciplinaires.
L’obligation de réserve
L'obligation de réserve ne figure pas dans les textes du Statut mais a été développée par la jurisprudence. Elle prolonge, en dehors du service, trois obligations : celles de neutralité, de secret et de discrétion professionnels.
Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu'il s'exprime publiquement (dans les médias, sur réseaux sociaux...) doit veiller à ce que ses propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses collègues, à sa hiérarchie... de manière trop directe et violente. Il doit donc faire preuve de mesure.
Elle varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression). L’agent qui occupe une fonction d’autorité est soumis plus sévèrement à cette obligation.
L’obligation de transparence pour les hauts fonctionnaires
(articles L 122-2 à L 122-25 du Code général de la fonction publique)
Chaque agent public est potentiellement exposé à des conflits d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions. Il doit remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité.
Tout haut-fonctionnaire a deux mois pour envoyer une déclaration de son patrimoine. Ces dispositions permettent de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique.
Ce dispositif complète les dispositions prévues pour les responsables politiques par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.