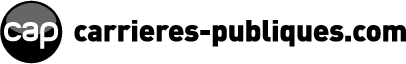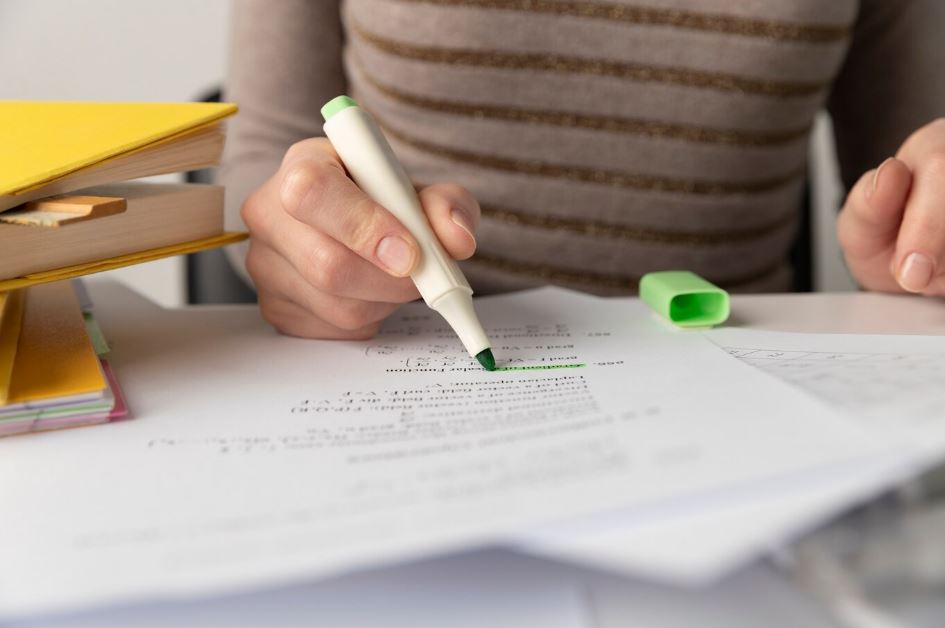Lors des épreuves de note de synthèse des concours de la fonction publique de catégorie A et B, est-il conseillé d’apprendre par cœur des plans type ? Si la structure binaire « Diagnostic / Propositions » est un modèle efficace et facile à retenir, que faut-il en faire pour obtenir plus de 15/20 ? On vous explique tout !
1. Pourquoi apprendre des plans types est-il intéressant pour bien se préparer ?
L’épreuve de note de synthèse ou encore, de rapport ou de cas pratique vise à évaluer vos capacités d’analyse, de diagnostic, d’organisation méthodique des informations nécessaires à la rédaction, d’argumentation, dans un temps limité, d’un document (note) synthétique. Concrètement, il s'agit en 3 ou 4 heures, de rendre, de façon claire et concise, une note informationnelle - 5/6 pages suffisent – avec des propositions soit plutôt générales, issues du dossier, soit plus personnelles mais toujours, pertinentes, stratégiques contenant des axes (leviers, freins), des moyens, voire un calendrier de déploiement, s’il s’agit de faire des propositions opérationnelles.
Donc l’idée d’aller mémoriser des plans type pour être certain d’être efficace le jour J est une bonne chose. Pour cela, vous pouvez lire des bonnes copies, regarder des corrigés, et les apprendre par cœur. De cette manière, cela peut vous donner de l’inspiration.
2. Quels sont les plans type de la note de synthèse ?
Pour réussir l’épreuve, il est également important de savoir qu’il a effectivement des plans type ou plutôt une architecture globale de la note de synthèse. Cette architecture reprend la dynamique de l’épreuve : il s’agit de faire dans une première partie, l’analyse du sujet, avec le cadre et le diagnostic du sujet ; puis dans une deuxième partie, des propositions, des recommandations, avec la stratégie et le déploiement des actions proposées.
Concrètement, une des bonnes pratiques est de commencer par les enjeux c’est-à-dire, l’importance du sujet. Vous allez définir le cadre du sujet (son contexte, les dispositions légales,…) avant de poser un « diagnostic », un état des lieux.
Typiquement, vous allez tout d’abord, définir le sujet, donner des notions, si cela n’a pas été fait en introduction, présenter les enjeux globaux (environnementaux, économiques, économiques…), les objectifs-cibles des politiques publiques (ex. la volonté affirmée lors de la campagne présidentielle, une feuille de route gouvernementale), le contexte réglementaire qui répond à cette situation et, présenter les acteurs clés qui mettent en œuvre concrètement les dispositions juridiques.
Puis, vous allez mettre en évidence, les points de vigilance si le dossier les présente : les points sensibles (ex. multiplicité des acteurs), des écueils (ex. des objectifs larges), les difficultés (ex. un planning serré), les freins qui font que la situation n’est pas idéale, les contraintes sociales et financières, mais aussi les bonnes pratiques, des exemples de mise en œuvre des dispositions, d’actions concrètes qui permettent d’avancer vers l’objectif-cible.
Enfin, vous terminerez votre première partie, par les leviers, c’est-à-dire les moyens d’action concrets à votre disposition pour avancer vers l’objectif.
Ensuite en deuxième partie, vous allez faire des propositions, présenter des recommandations (avantages, inconvénients, conditions de réussite). Là encore, il vous faut envisager tous les aspects : juridiques, sociétaux, environnementaux, économiques, financiers, managériaux… y compris les principes déontologiques relatifs au service public (intérêt général) et maitriser les notions de planification.
Il s’agit de répondre à la question « comment faire ? », avec typiquement, dans une sous partie, la stratégie : les objectifs, les conditions de réussite. Vous pouvez proposer de compléter cette organisation par la mise en place d’une équipe projet. Dans ce cas, vous devez aborder la composition de cette équipe, traiter la question du reporting, des livrables, des comptes-rendus et de leurs destinataires…Vous aurez surement aussi à indiquer comment est définie la gouvernance, qui décide, qui pilote opérationnellement. Et dans une seconde sous-partie, vous traiterez du déploiement : les principaux axes, les moyens, avec un rappel éventuel de la date cible (ex. avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, d’un nouveau décret ou d’une circulaire de droit public) avant de présenter un rétroplanning, un calendrier et enfin, l’évaluation.
Toutefois, en 4 heures (ou 3), vous n’avez pas beaucoup de temps pour le faire. Aussi, définissez les grandes lignes. Ce que l’on vous demande c’est de voir ce qu’il y a à faire et pas forcément de faire.
3. Mais alors, pour quoi apprendre par cœur des plans type n’est-il pas suffisant ?
Mais la préparation à l’épreuve de note de synthèse ne s’arrête pas là, bien entendu. Pour avoir une bonne note, il ne suffit pas de « plaquer » ce cadre type à tous les sujets.
Lors de l’épreuve, à la lecture du sujet posé, il est vrai que le plan est suggéré. Généralement, le sujet va vous demander de voir deux ou quatre points. Au premier abord, cela peut donc paraître simple et donner l’impression que le correcteur attend de vous que vous remplissiez des cases.
Par exemple, lors du concours d’attaché territorial 2023, il était demandé aux candidats de rédiger une note sur l'attractivité de la Fonction Publique Territoriale (FPT) et le sujet indiquait le contexte de la collectivité : ces dernières années, elle connait « des problématiques accrues en matière de recrutement, une attractivité de plus en plus questionnée, de nombreux services en tension avec un impact sur le fonctionnement et la qualité des services publics ».
La binarité type serait de faire deux parties avec deux sous parties portant :
- dans la première partie (I) sur les enjeux (les enjeux de l’attractivité pour les employeurs des collectivités territoriales : qualité de service public et fonctionnement) ;
- et dans la deuxième (II) sur les actions à engager pour susciter des vocations publiques et améliorer l’attractivité dans la Territoriale.
En apprenant des plans type, il pourrait être compris que pour tout sujet portant sur l’attractivité, il « suffit » de reprendre le plan ci-dessus. Cette pratique est en fait risquée. Dans un concours, le jury attend de vous le meilleur. Une bonne copie à l’écrit, permettra de vérifier que vous êtes un futur bon professionnel de la fonction publique. Dès lors, les correcteurs vous demandent un raisonnement stratégique et donc, un plan cohérent et non « passe-partout ».
En voulant à tout prix apprendre par cœur des plans type, vous risqueriez de ne plus réfléchir de manière suffisante et donc, de ne pas voir les spécificités du sujet. Cela pourrait vous conduire à oublier des éléments essentiels du dossier, ou à chercher exclusivement ceux qui correspondent absolument au plan-type, ce qui nuirait à la qualité de votre copie.
Pour illustrer, si le dossier dans l’exemple précité avait traité de la question de la rémunération (exemple : mise en place de mesures catégorielles d'ampleur pour renforcer l'attractivité de la fonction publique, ciblées sur des filières professionnelles en tension, conjuguées avec les mesures générales, …), il aurait été indispensable de faire une sous partie sur les délibérations RH à prendre en la matière par la collectivité pour assurer aux agents concernés des gains de rémunération immédiats et de meilleures perspectives d'évolution mais, il aurait peut-être alors été nécessaire d’attirer la vigilance de la collectivité sur un point budgétaire (ndlr - le poids des dépenses salariales publiques étant sur le plan national, en train de retrouver le niveau d’avant la crise sanitaire liée au COVID-19).
En quatre heures, le plan type aide. Certes, cela étant ce qui va être essentiel, c’est de traiter le dossier. Et tout le dossier. Ce qui va transformer une copie moyenne en copie « gagnante », c’est votre logique. Pour cela, tout va dépendre des informations qui se trouvent dans le dossier et comment vous les catégoriser et les hiérarchiser. L’épreuve de note de synthèse demande aussi de prendre du recul, c’est-à-dire de resituer dans un contexte le sujet bien sûr, mais aussi prendre du recul par rapport à une politique publique, à ses enjeux. Il est des sujets où il est important, au vu des enjeux s’ils sont nombreux, de les développer en première partie, et d’autres sujets, où les indiquer en introduction suffit. De la même manière, pour l’état des lieux ou le cadre légal. Ces derniers seront peut-être en sous parties.
Puis, une fois ce travail achevé, il va vous falloir développer une argumentation personnalisée et dynamique.
4. En quoi, proposer un plan personnalisé et stratégique va vous permettre de convaincre votre correcteur ?
Le plan type doit servir …d’armature à votre argumentation. Le destinataire de votre écrit a des besoins, il doit prendre une décision adaptée à la problématique posée. Dès lors, il doit pouvoir comprendre la logique que vous avez suivie, ce qui est important et voir les liens que vous avez faits. Et c’est pour cela qu’un plan argumenté, dynamique avec des transitions, une organisation de l’idée la plus importante à des exemples bien choisis, vous permettra de convaincre le destinataire de votre copie et de gagner des points.
Il faut donc vous demander notamment, si le cas posé vous appelle à faire des propositions ciblées ou à proposer un véritable plan d’action global. Par exemple, le cas posé par le sujet peut vous conduire à proposer un plan de communication (ex. le marketing territorial est en plein développement), c’est-à-dire un livrable très précis ; mais il peut aussi vous être demandé un plan d’action global avec alors des objectifs. Très souvent, il s’agira de mettre en œuvre un dispositif.
Sachez aussi, qu’il est des sujets où des propositions opérationnelles plus personnelles vous sont demandées. Le sujet vous impose donc de sortir de votre « zone de confort », du sujet classique où le candidat présente un dispositif (ou une réforme), les cas dans lesquels il (ou elle) s’applique. Vous êtes alors plus libre dans ce que vous allez apporter comme éléments à votre destinataire. Se limiter au plan type serait alors encore dangereux.
Quel que soit le sujet, vous comprenez donc que tout bon plan contient des étapes obligées, presque mécaniques, d’où l’intérêt de connaitre le plan type. Mais cette architecture doit vous aider, elle ne doit pas vous empêcher de réfléchir. Autrement dit, ce qui va faire la différence, c’est votre capacité d’analyse de la situation de travail, d’argumentation, de présentation des points sensibles, que vous avez mis en évidence dans la première partie de votre note, toujours rédigée à l’aide (exclusivement) des (et de tous les) éléments du dossier puis des propositions d’actions.
5. Quels éléments peuvent vous rapporter plus de points encore ?
Enfin, si viser une copie parfaite est impossible, vous pouvez envisager de rendre la meilleure copie. Sur la forme, veillez à lier par des phrases de transition, les éléments de diagnostic, de mise en contexte (première partie) à vos propositions (deuxième partie). La seconde partie ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Une bonne transition entre la première et votre seconde partie vous facilitera le travail.
Pour présenter votre écrit, pensez également à systématiquement, hiérarchiser vos arguments.
Par exemple, en catégorisant la nature des actions, des leviers ou en mettant en avant :
- les idées importantes, des mots clés, des principes (d’adaptabilité, d’exemplarité, de continuité de service public,…) ; ou encore,
- en première partie, des points de vigilance, puis, en seconde partie, des moyens concrets d’actions prenant en compte ces points.
Mettre toutes les chances de votre côté : Vous préparer avec l’aide d’un organisme
Retrouvez les préparations aux concours de catégorie A et B (attaché territorial, rédacteur territorial, technicien territorial, chef de service de police municipale) de Carrières Publiques.
Bonne préparation !