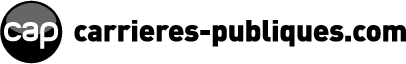Lors des épreuves du rapport, de note de synthèse ou encore, de cas pratique des concours de la fonction publique de catégorie A et B, les sujets à traiter portent sur des dispositifs mais aussi des réformes récentes. Comment avoir une note au-dessus de 15/20 ? Pour cela, vous devez être capable de proposer un plan dynamique qui sort des standards. Et pour y arriver, voici 5 conseils clés méthodologiques à partir d’un exemple concret.
Pour avoir une excellente note …
L’épreuve de cas pratique, de note ou encore, de rapport vise à évaluer vos capacités d’analyse, de diagnostic, d’organisation méthodique des informations nécessaires, et enfin, d’argumentation, dans un temps limité, d’un document (note ou rapport) synthétique bien rédigé. Concrètement, il s'agit en 3 ou 4 heures, de rendre, de façon structurée, claire et concise, une note informationnelle - 5/6 pages suffisent – avec des propositions soit plutôt générales, issues du dossier, soit plus personnelles mais toujours, pertinentes, stratégiques contenant des axes (leviers, freins), des moyens, voire un calendrier de déploiement, s’il s’agit de faire des propositions opérationnelles.
Pour vous évaluer, les jurys vont donc vous demander de traiter des sujets d’actualité, dont bien sûr les réformes récentes.
Conseil n°1 - Présenter de manière dynamique la réforme
Comment présenter une réforme sans que votre note soit trop scolaire, trop longue ? Et bien il faut éviter d’énumérer des dispositions les unes à la suite des autres. Dans un concours, le jury attend de vous le meilleur. Une bonne copie permettra de vérifier que vous êtes un futur professionnel de la fonction publique de qualité. Dès lors, les correcteurs vous demandent un raisonnement stratégique et donc, un plan dynamique.
Prenons un exemple concret avec la réforme des parcours des démarches des personnes en situation de handicap et des MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) dont les mesures ont été rendes publiques le 18 juillet 2025 à l’issue du « Tour de France des solutions Handicap » de la Ministre déléguée chargée de l'Autonomie et du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Une manière dynamique de présenter les 18 mesures serait de montrer comment une réforme s’inscrit dans un contexte, poursuit des objectifs, fait le choix d’un certain nombre de leviers et bien sûr, inclus des dispositions opérationnelles. Le plan reste classique mais vous évite d’être attiré dans les filets soporifiques de l’énumération.
Conseil n°2 – Faire ressortir le contexte et les objectifs de la réforme
Vous allez donc commencer par présenter le contexte.
Le contexte part d’un constat : les MDPH créées par la loi Handicap du 11 février 2005 jouent un rôle central, mais elles sont parfois entravées dans leur action. L’école inclusive monte en charge, le rôle de France Travail se renforce, la branche autonomie a été créée et l’offre médico-sociale est en pleine transformation, or, il s’agit de dispositifs au cœur des politiques publiques du handicap ce qui modifie les attentes, les rôles des MDPH.
Et derrière les discours théoriques, se cache une réalité affligeante : les personnes en situation de handicap et leurs familles se heurtent depuis des années à des procédures administratives complexes pour faire valoir leurs droits. Les formulaires sont lourds, les délais d’attente trop longs (certains dépassent les 10 mois) et les pratiques varient considérablement d’un département, d’une MDPH ou une MDA (maison de l’autonomie) à l’autre, ce qui crée de fortes inégalités. Chaque jour, des personnes, des aidants et des professionnels alertent sur une situation injuste : obtenir une réponse claire et un accompagnement humain relève souvent d’un long parcours complexe. Il s’agit donc d’obtenir plus de simplicité, moins de dossiers à réaliser, et surtout, un suivi humain continu.
Voici une première manière de présenter le contexte. Et pour cet exemple, vous pouvez la rendre plus dynamique en ajoutant que ces constats sont partagés, majoritairement, par les directeurs et le personnel des MDPH et MDA. Face à la massification des demandes, ils expriment en effet, leurs besoins, depuis des années, d’outils modernes pour une évaluation juste, globale et pluridisciplinaire (médicale, sociale, éducative) du handicap mais aussi pour répondre aux attentes des usagers à l’ère du « tout numérique », de repenser l’ensemble du dossier et de simplifier les démarches au profit de tous, d’un cadre administratif harmonisé et d’un accompagnement renforcé pour mieux faire leur métier.
Et bien sûr la réforme cherche à résoudre cette équation. Ainsi vous allez faire ressortir la problématique : ici, il ne s’agit pas de repartir à zéro mais de faire évoluer la situation. En effet, il s’agit de réfléchir à comment transformer les MDPH pour leur donner les moyens d’être pleinement ce qu’elles doivent être, à savoir des lieux accessibles, lisibles, humains, au service des parcours de vie de chacun.
Une fois cette présentation faite, vous allez ensuite, pouvoir présenter les objectifs de la réforme. Ces mesures visent à améliorer ce qui existe, avec ceux (professionnels des MDPH et autres acteurs des administrations, les associations et les services) qui agissent chaque jour. Elles ont pour but de simplifier les démarches, rendre les parcours plus fluides, d’harmoniser les pratiques sur tout le territoire et offrir une meilleure lisibilité des droits – tout en s’appuyant sur le travail quotidien et engagé des équipes des MDPH et l’application des dispositions déjà existantes.
Conseil n°3 – Proposer un diagnostic et décliner les enjeux
Ensuite, vous allez présenter les enjeux, les leviers, les opportunités et peut-être également, les freins ou les points de vigilance que les décideurs de votre écrit doivent avoir en tête.
Dans le cadre de notre exemple, l’état des lieux a été fait en partie également dans un rapport, établi dans le cadre du programme de travail 2024 de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), et qui est précurseur à la réforme. Ce rapport évalue comment les MDPH fonctionnent aujourd’hui, autour des trois temps : accueil / évaluation / décision des demandes des usagers. La mission a instruit en particulier la manière dont l’évaluation des besoins de compensation face au projet de vie est réalisée en MDPH ; la place accordée aux usagers tout au long du traitement de leur demande ; les outils, dont ceux élaborés par la CNSA, utilisés par les MDPH pour traiter les demandes ; le rôle joué par les différents acteurs formant l’écosystème des MDPH (conseils départementaux, Éducation nationale, service public de l’emploi, autres branches de sécurité sociale, associations, en particulier) et la fonction de pilotage exercée par la CNSA ; les moyens, la charge et la qualité de service à l‘aune des objectifs et indicateurs définis au niveau national.
Le rapport souligne un écart entre les promesses légales (loi 2005) et la réalité sur les délais, la qualité des décisions, l’équité territoriale. Il note que depuis 2005, des progrès ont été accomplis, les MDPH ont fait des avancées sur l’accueil et l’information : l’usager parfois mieux informé, des services en ligne, des améliorations de dispositifs d’accueil mais le fonctionnement reste inégal selon les territoires en matière de pilotage, de portail usagers, de téléservices, etc. …Le droit à compensation commence également à mieux répondre, dans plusieurs cas, aux attentes des usagers.
Mais les difficultés et les limites restent importantes : les délais de traitement des demandes sont trop longs, et varient beaucoup ; la charge de travail des MDPH augmente, sans que les moyens (humains, techniques, organisationnels) suivent toujours. Le modèle « tout départemental / guichet unique » est sous tension : il a ses forces (concentration des demandes, centralisation de l’accueil) mais aussi ses coûts, ses lourdeurs (complexités organisationnelles, retards, surcharge). Un des leviers serait, selon le rapport, d’améliorer la gouvernance et la collaboration avec les autres acteurs (services départementaux, médico-sociaux, service de l’emploi, etc.) mais également, d’étendre la responsabilisation des acteurs « d’aval » (Éducation nationale, établissements médico-sociaux, etc.) : leur donner plus de latitude d’exécution une fois les besoins évalués / notifiés afin de pouvoir alléger la charge de travail des MDPH.
Par ailleurs, les outils de travail, de gestion de dossiers, de suivi, ne sont pas toujours à la hauteur : systèmes d’information hétérogènes, peu ou pas partagés, ce qui rend difficile la cohérence et la réactivité.
Quant à la place de l’usager, il reste « au centre » mais sa place est insuffisante dans certains procédés : clarté des décisions, explications des motifs de refus ou de décisions complexes, accès à l’information. Un des enjeux est donc de rendre le parcours clair.
Conseil n°4 – Ne pas tomber dans le piège de l’énumération en présentant les axes principaux
Vous avez donc fait le diagnostic, un état des lieux, vous allez donc pouvoir maintenant présenter les décisions et outils principaux de la réforme. Là aussi, il ne faut surtout pas tomber dans le travers de l’énumération des mesures nombreuses et non hiérarchisées. Vous devez en mettre en évidence des axes forts, comptez trois ou quatre axes pas plus.
Par exemple, dans cette réforme des MDPH, quatre axes sont identifiés : un premier axe vise à alléger les démarches avec comme leviers choisis la simplification des formulaires, une meilleure communication entre les partenaires pour une expérience plus fluide pour les usagers. Il s’agit d’un axe qui vise à améliorer la qualité du service rendu à l’usager.
Ensuite, le deuxième axe vise à « écouter, orienter, accompagner » les usagers avec un dispositif applicable sur tout le territoire, et très important « le rendez-vous primo-demandeur ». Ce moment organisé par les MDPH vise à créer un premier contact personnalisé avec les usagers qui font leur demande pour la première fois, permettant de leur expliquer clairement les différentes démarches, les pièces justificatives à fournir pour faciliter la constitution du dossier et son évaluation, et les aides auxquelles ils ont droit. Un rendez-vous qui est destiné à donner l’occasion aux usagers de poser toutes leurs questions et d’être orientés vers les bons interlocuteurs. Une manière d’assurer un accompagnement plus humain et plus efficace.
Le troisième axe vise à simplifier et réduire les délais. Très concrètement, face à ce besoin urgent de simplification, un nouveau formulaire co-construit avec les personnes, les associations et les agents des MDPH va voir le jour. Il se veut plus simple, plus court, plus clair, et surtout plus adapté à chaque situation. Autre mesure, si aujourd’hui la liste et la durée de validité des pièces administratives (titre de séjour, certificat médical, justificatif de domicile) diffèrent selon les départements, la réforme s’engage à définir par arrêté une liste nationale harmonisée des pièces justificatives, apportant une réponse structurelle à une attente forte : celle d’un service public plus lisible, plus équitable, plus prévisible. Un contenu que vous retrouvez dans d’autres réformes ou programmes d’amélioration des services publics en France (cf. Services Publics+). Vous pouvez alors mettre en avant, par exemple, la notion de « démarche qualité » et la recherche d’efficacité que souhaite le gouvernement actuel.
Enfin, le quatrième axe vise à soutenir les agents des MDPH et moderniser leurs outils. Au-delà de la formation, pour réduire les délais d’attente, éviter les ruptures de parcours et garantir l’équité de traitement, le gouvernement fait le choix d’innover. Un outil est mis en avant : l’intelligence artificielle. Entre parenthèses, cet outil vous le retrouverez certainement dans d’autres sujets d’actualité aux concours 2025 2026. En effet, le potentiel de l'IA pour améliorer les politiques publiques, avec ses risques (écologiques, …) et le cadre juridique (le règlement général sur la protection des données RGPD, la loi informatique et libertés) à prendre en compte est un sujet brulant et un enjeu fort des administrations françaises. Ici, elle sera expérimentée pour automatiser et fiabiliser l’étape de recevabilité des dossiers (présence des pièces justificatives, cohérence des données) et réduire les délais. Bien sûr, la prudence et la méthode sont de rigueur, l’IA ne devant jamais remplacer l’analyse humaine des situations.
Conseil n°5 – S’entrainer, en suivant une formation en ligne
En résumé, vous avez exposé une réforme en présentant les enjeux, un contexte, une situation initiale et les leviers qui ont été choisis par les porteurs du projet de cette réforme afin d’atteindre les objectifs en mettant en avant les axes forts, non pas en listant des dispositions, les unes à la suite des autres mais en les restituant dans une logique de politique publique.
Quel que soit la réforme, cette présentation structurée peut convenir et répond à l’objectif de l’épreuve : faire une synthèse, pas seulement un résumé. Vous comprenez donc que toute bonne présentation contient des étapes obligées, presque mécaniques. Ce qui va faire la différence, c’est votre capacité d’analyse de la situation, votre capacité d’argumentation et de mise en avant des points sensibles, éléments que vous allez mettre en évidence à l’aide exclusivement des éléments du dossier.
Maintenant, pour vous entraîner et mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez vous préparer avec l’aide d’un organisme par le suivi d’une formation en ligne. Une ressource qui vous donnera l’occasion d’avoir des exemples et des méthodes sur la façon de structurer une présentation de réforme dans une épreuve de concours de la fonction publique.
Pour cela, vous retrouverez toutes les préparations aux concours de catégorie A et B (attaché territorial, rédacteur territorial, technicien territorial) sur le site de Carrières Publiques.
Bonne préparation !