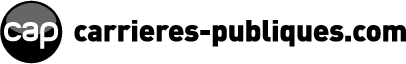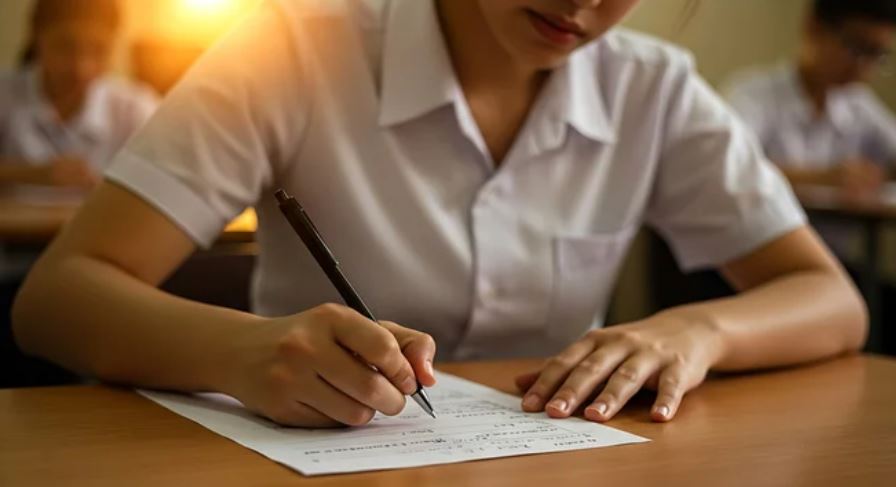Chaque année, des milliers de candidats se lancent dans l’aventure des concours et examens professionnels de la fonction publique, souvent sans connaître les dessous de cette grande machine. Entre la préparation des épreuves, le choix des jurys et les petites astuces qui font la différence, on vous révèle 10 vérités que vous n’aviez peut-être jamais imaginées. Accrochez-vous, l’envers du décor est aussi fascinant que surprenant !
1. Combien de temps prend l’organisation d’un concours de la fonction publique ?
Qu’il s’agisse d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, de catégorie A, B ou C, toute filière concernée (administrative, technique,…), l’organisation logistique pour les organismes organisateurs (centre de gestion, CNFPT, IRA, INSP, CNG, ministères,…) demande généralement entre six et douze mois de préparation. Dans la FPT, par exemple, le délai permet de coordonner les centres de gestion, de recenser les postes vacants et les besoins auprès des collectivités (communes, départements, régions) de réserver les lieux, de recruter les surveillants, et de s’assurer que tout soit conforme aux exigences juridiques.
2. Comment sont conçus et choisis les sujets des épreuves ?
Le choix des sujets est une compétence propre du jury, qui doit l’exercer dans le respect du texte d’organisation du concours. Il doit être conforme au programme (s’il existe) ainsi qu’à la réglementation particulière à chaque épreuve.
En général, les sujets des épreuves sont définis en fonction des métiers visés, des compétences requises, et des besoins des administrations. Les centres de gestion, les ministères et parfois même des commissions spécialisées se concertent pour établir des sujets pertinents et actualisés.
Six mois avant le début des épreuves, les membres des jurys sont tenus de participer à une réunion de cadrage avec le président du jury au cours de laquelle leur sont données les consignes relatives à l’élaboration des sujets des épreuves. Le président a notamment pour rôle de leur rappeler que : « l’absence d’ambiguïté dans la formulation des questions ainsi que dans l’expression des données est essentielle parce qu’elle évite les interrogations des candidats et les difficultés de correction, voire des risques de recours en cas de grave défaut de formulation ou d’énoncé ». Le choix d’une question en dehors des limites du programme peut entraîner un contentieux d’annulation.
De même, le président se doit de recommander au jury de ne pas « alourdir inutilement le sujet par des annexes en trop grand nombre du fait que leur multiplication ne contribue pas forcément à éclairer le candidat. À partir de ces recommandations, pour les concours territoriaux, des sujets sont conçus par des fonctionnaires d’1 ou 2 grades supérieurs pour les concours de catégorie C (en catégorie A et B les sujets sont nationaux). En somme, tout est conçu pour que vous ne soyez pas surpris par l’énoncé mais, cela ne veut pas dire que vous tomberez sur votre sujet de prédilection.
Et si malgré tout le jour J le sujet paraît douteux ? Si un candidat conteste le libellé du sujet ou d’une question le jour des épreuves, celle-ci relève de l’appréciation du jury qui peut décider jusqu’à l’annulation de l’épreuve (c’est très rare dans les faits). C’est pour cela que les présidents et les auteurs des sujets doivent pouvoir être joints à tout moment, par téléphone, en cas de besoin (source : Guide pratique des concours administratifs à l’usage des présidents et membres de jurys édition 2015). Toutefois, une erreur mineure de rédaction qui ne dénature pas l’énoncé n’est pas un cas d’annulation de l’épreuve.
3. Qui corrige les copies des épreuves écrites et selon quels critères ?
Tout concours de la fonction publique ou examen professionnel (EP) obéit à une règle fondamentale, qui est que : « les candidats sont jugés uniquement en fonction de la valeur des épreuves et que celles-ci doivent se dérouler de manière à ce qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité ». Ce principe, qui est l’essence même du concours et en fonde toute la réglementation, a été réaffirmé dans la charte du 2 décembre 2008 pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique et dans la charte du 17 décembre 2013 pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.
Quelle que soit l’épreuve écrite que devront subir les candidats (composition, note administrative ou note de synthèse, questions à réponse courte/QRC, questions à choix multiple/QCM, plus rarement résumé ou analyse de texte), elle doit permettre de vérifier :
- les connaissances générales ou disciplinaires,
- la capacité à construire un plan,
- la mise en valeur par écrit des idées,
- la capacité de rédaction.
En pratique, pour noter les candidats, les correcteurs s’appuieront sur le corrigé de l’épreuve et le barème de notation fournis par l’auteur du sujet. Chacun des correcteurs est responsable de son lot de copies.
Le jury ne doit tenir compte, pour départager les candidats, que de la seule valeur des épreuves telles qu’elles sont fixées par la réglementation.
4. Est-ce que la double correction est obligatoire ?
La réponse est …non. La double correction n’est obligatoire que si le règlement du concours le prévoit : si tel n’est pas le cas, le jury peut décider de soumettre seulement certaines épreuves à une double correction.
Par ailleurs, rien n’oblige les correcteurs à porter des appréciations sur les copies. Cela présente même des inconvénients techniques en cas de double correction ; même si le fait que le deuxième correcteur connaisse la note ou les appréciations du premier correcteur ne constitue pas une cause d’annulation retenue par la juridiction administrative.
Le président du jury peut demander à voir les copies et prescrire une nouvelle correction en cas d’anomalies (par exemple : lorsque les notes chiffrées attribuées par les deux correcteurs sont très divergentes). Enfin, toujours afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, à la « péréquation » des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. La péréquation reste une opération assez délicate à mettre en œuvre, car elle soulève une difficulté supplémentaire. Elle va en effet « dans deux sens opposés, permettant à la fois une augmentation de certaines notes, afin d’en rattraper d’autres, et, dans le même temps, la diminution de certaines notes afin de les rapprocher de la moyenne des autres » (…) « La péréquation dépasse l’égalité pour viser l’équité dans la notation des agents » (source : « La péréquation dans le droit de la fonction publique » (F. Colin – AJFP 2002 p 4)).
5. Que se passe-t-il si à l’oral, un candidat et un membre du jury se connaissent ?
Lors des épreuves orales, si l’un des membres du jury connaît personnellement l’un des candidats qu’il devra interroger, est une situation dans la réalité assez rare mais possible. Elle d’ailleurs envisagée par les règlements de concours et EP, l’objectif étant de garantir la neutralité et l’impartialité des jurys en toutes circonstances.
Dans ce cadre, la liste des candidats convoqués à chaque vacation est remise aux membres des groupes d’examinateurs en début de séance. Et si la situation se révèle et que les liens entre le membre du jury et le candidat sont de nature à influer sur son appréciation, il doit en avertir le secrétaire. Le candidat devra alors passer devant un autre groupe d’examinateurs.
Si cela n’est pas possible matériellement, le membre du jury concerné ne doit pas quitter la salle pendant l’interrogation du candidat ; il lui est en revanche, demandé de s’abstenir de poser des questions et bien sûr, de délibérer.
6. Les candidats anonymes… le sont-ils vraiment ?
L’obligation de « rendre une copie rendue anonyme par vos soins » selon la formule consacrée et de ne pas apposer de « signe distinctif » est inscrite noir sur blanc dans le règlement général des concours et examens édicté par les organismes organisateurs et publié sur leur site web.
La règle de l’anonymat est prise très au sérieux par le jury. L’anonymat des épreuves écrites est une garantie d’impartialité de ce dernier ; en conséquence la levée de l’anonymat constitue une irrégularité qui entraîne l’annulation des épreuves. Et en cas de signe distinctif ou de rupture de l’anonymat, le jury décidera de l'attribution de la note… zéro. Un zéro à l'épreuve, étant une note éliminatoire, cela entrainera directement pour le candidat concerné, l'exclusion du concours ou de l’EP. Vous êtes donc prévenu !
L'anonymisation de votre copie ne sera pas faite par les correcteurs mais par les agents en charge de l'organisation du concours, avant correction. C’est pour cela que le jour de l’épreuve, vous allez devoir indiquer, dans le cadre carboné situé en haut de votre copie : votre nom, votre prénom, votre numéro de convocation. Donc pensez à bien imprimer votre convocation car une fois dans la salle, les téléphones portables doivent être éteints. Ensuite, vous devrez veiller à coller soigneusement le cadre supérieur de votre copie.
Les agents en charge de l’organisation du concours vont supprimer le volet qui comporte votre nom et attribuer un numéro à votre copie en plus de votre numéro de candidat avant que votre copie soit soumise à une double correction.
Les correcteurs ne disposeront que des copies numérotées et n'auront ainsi aucun moyen de connaître votre identité. L'anonymat des épreuves sera levé qu'après délibération du jury.
7. Après la diffusion des résultats, les candidats peuvent-ils avoir accès à leur copie ?
Un candidat à un examen ou à un concours qui le souhaite est autorisé à consulter sa copie après les résultats de celui-ci : « la copie d’un candidat à un examen ou à un concours constitue un document nominatif. Le candidat a donc le droit d’en avoir communication. » (source : Guide pratique des concours administratifs à l’usage des présidents et membres de jurys édition 2015)
Attention cependant, vous devez avoir en tête que les épreuves d’un concours visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de l’accès à un emploi public. Il ne s’agit pas de « devoirs universitaires » donnant lieu à correction détaillée portée sur la copie dans un but pédagogique. Dans ce cadre, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige un jury à justifier les notes qu’il attribue. La jurisprudence considère qu’un jury n’est pas obligé de motiver ses délibérations, ni de faire figurer une appréciation rédigée sur les copies des candidats. La justification des notes est donc laissée à l’appréciation du jury.
En revanche, pour le candidat ayant obtenu la note 0 ou la note éliminatoire à une épreuve, s’il demande des explications, il doit pouvoir les obtenir dit le Guide de la DGAFP : « même dans le cas d’un concours pour lequel aucune appréciation écrite n’a été consignée, il importe que la note 0 ou la note éliminatoire soit assortie des motifs qui ont conduit le jury à l’attribuer sous la forme d’un rapport écrit à remettre au président du jury avant la délibération de celui-ci. »
8. Quels autres documents, le candidat peut-il consulter ?
Une fois les résultats communiqués, le candidat a aussi accès aux annotations qui auraient été portées sur des documents autres que sa copie : « en effet, une trace écrite de l’appréciation d’ensemble synthétique du travail de chaque candidat peut aider le jury à garder la mémoire des traits marquants de la prestation (notamment lors des discussions collégiales pour harmoniser les notes ou classer les candidats en cas d’établissement d’une liste complémentaire). Lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, (par exemple dans une case réservée à cet effet sur la grille de notes remises aux correcteurs), elles ont le statut de document administratif dont un candidat peut demander la communication […]. Il n’y a pas de distinction à faire suivant qu’ils ont été remis aux services administratifs permanents qui organisent le concours ou conservés par les membres du jury. » (source : Guide de la DGAFP)
« Deux situations se présentent donc :
1. Des appréciations ont été formulées par écrit sur les travaux de l’ensemble des candidats dans les épreuves : elles sont communicables de plein droit à tout candidat qui en fait la demande, à titre individuel en ce qui le concerne personnellement.
2. Aucun document écrit comportant des appréciations n’a été établi par le jury : l’impossibilité de communiquer des appréciations matériellement inexistantes doit être expressément indiquée au candidat qui en fait la demande. »
Attention : cette démarche qui doit être effectuée dans un délai d’un an à compter de la date de la première épreuve ne donne pas droit pour autant à contester la note attribuée, ni l’appréciation du jury sur la valeur des copies, ni les principes de correction qu’il a retenus. Il s’agit « d’éclairer davantage le candidat, qui par exemple, cherche à réussir lors d’une prochaine session, sur les éléments qui ont conduit le jury à attribuer telle note à son travail dans une épreuve. […] Elle n’a aucunement pour effet de porter atteinte ou de restreindre le caractère souverain de l’appréciation portée par le jury qui demeure insusceptible d’être contestée utilement devant le juge administratif. »
Néanmoins, cette possibilité laissée aux candidats de consulter leurs copies garantit une nouvelle fois la neutralité et l’objectivité que le jury doit garder à l’esprit.
9. Quels sont les secrets d’une copie qui se démarque ?
Les rapports de jury sont unanimes : Pour une bonne copie de concours, il faut d’abord une structure claire, avec une introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion. Ensuite, il faut être précis, utiliser des exemples concrets, et surtout, bien respecter le sujet et les consignes. Un bon style, sans fautes d’orthographe, et une argumentation rigoureuse font aussi la différence. Et bien sûr, un petit truc en plus, c’est d’apporter une touche personnelle et réfléchie.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, deux méthodologies s’offrent à vous : soit vous préparer seul grâce aux annales et aux manuels de préparation, soit solliciter le soutien d'un organisme de préparation avec des entraînements à la maison grâce notamment, à carrières publiques.
10. Comment est établie la liste des admis ?
L’article 20 de la loi du 11 Janvier 1984 prévoit que : « chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (…) sauf s’il en est disposé autrement » (fonction publique territoriale ou texte spécial prévoyant, par exemple, le classement par ordre alphabétique – cf. Code général de la Fonction publique : articles L325-36 et suivants pour la FPE, art. L325-68 et suivants pour la FPT et art. L325-47 et suivants pour la FPH).
Le classement est établi selon le nombre de points obtenus – sous réserve d’éventuelles notes éliminatoires prévues par la réglementation du concours – à l’exclusion de toute autre considération.
Le jury établit également, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois. Dans les mêmes conditions que sur la liste principale, l’administration, lorsqu’elle nomme les candidats de la liste complémentaire, doit respecter l’ordre de classement établi par le jury.
Pour départager les éventuels ex-aequo le jury doit se conformer à la réglementation du concours. Si rien n’est prévu, il n’a pas le pouvoir « d’inventer » de nouvelles épreuves. Le jury peut ne proposer aucun candidat ou ne proposer qu’un nombre de candidats inférieur au nombre de postes ouverts au concours ou à l’examen, dès lors qu’il estime que certains candidats ne justifient pas du niveau exigé.
Un jury ayant délibéré une première fois et arrêté la note d’un candidat ne peut pas délibérer à nouveau et modifier cette note. Le jury ne peut modifier l’ordre de classement d’une liste arrêtée après délibération.
Bonne préparation avec Carrières Publiques !